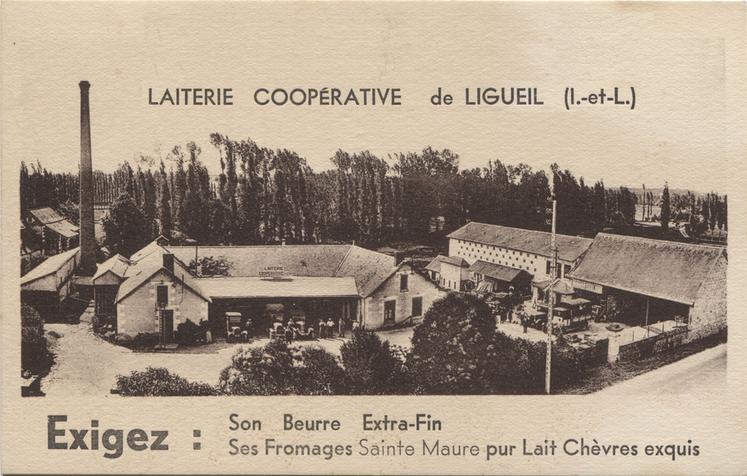Sources de protéines
Vers un rebond du lupin blanc ?
Le lupin libère le phosphore. Cette qualité récemment démontrée fera-t-elle regermer le fabuleux destin, tant de fois annoncé, de Lupinus albus ?
Le lupin libère le phosphore. Cette qualité récemment démontrée fera-t-elle regermer le fabuleux destin, tant de fois annoncé, de Lupinus albus ?

Lupin, le retour ? Ce serait presque un trait d’humour persifleur pour tous ceux qui, depuis un demi-siècle, ont cherché à implanter durablement cette légumineuse dans les rotations. Sacralisé dans les années 70-80 comme un soja à la française, le lupin produit une graine très riche en protéines (35 %).
Malgré une sélection variétale encore active, dont le catalogue comprend des variétés hiver et printemps privées des alcaloïdes indigestes pour les animaux, le lupin blanc est resté dans son terrier, au grand dam des sélectionneurs. La faute à qui ? La culture n’a tout simplement pas fait ses preuves aux champs de sa capacité à produire une récolte régulière et donc un revenu suffisant comparé aux autres options culturales. Les échecs en cultures ont refroidi les plus convaincus. Comme en colza, pratiquement 10 mois s’écoulent entre son semis en septembre et une entrée de la moissonneuse dans la parcelle en juillet. Le lupin souffre d’un tempérament peu conquérant d’espace et donc de la concurrence avec les adventices.
On pourrait croire la chose entendue et se résigner à laisser le lupin dans les limbes de l’histoire agronomique… sauf que depuis quelques mois le monde des aficionados de Lupinus albus connaît de nouveau l’effervescence de l’espoir pour deux raisons. Primo, les 38 000 gènes de son génome sont désormais décodés. Secundo, des chercheurs ont mis en évidence une qualité rare dans le monde végétal : sa capacité à libérer le phosphore présent mais piégé par des liens chimiques dans le sol. Benjamin Péret (Cnrs-Inrae-Sup Agro- Uni. de Montpellier), chercheur du consortium des onze laboratoires ayant séquencé le génome, désigne les racines protéoïdes de la plante comme capables de modifier le milieu chimique ambiant et de libérer l’élément phosphore dont elles ont besoin.
UNE PISTE DE SOLUTION POUR LE PHOSPHORE
Considérée comme le facteur limitant à horizon de trente ans pour la production alimentaire mondiale, la pénurie de phosphore trouverait ainsi une ébauche de solution. Car les ressources en phosphore sont minières et donc limitées dans le temps. Sur les 18 000 millions de tonnes extraites au Maroc notamment, seules 3 millions seraient réellement utilisées par les plantes cultivées. La recherche échafaude déjà le transfert des gènes impliqués à d’autres légumineuses, ou aux céréales.
Les agronomes, les agriculteurs pionniers, imaginent aussi des cultures en association blé-lupin. Car des essais ont déjà démontré l’absorption par le blé du phosphore ainsi libéré. Ingénieure développement chez Terres Inovia, Agathe Penant est convaincue de l’avenir de sa plante fétiche. Elle conduit des essais du Poitou en Normandie avec l’appui de coopératives comme Terrena.
Si le lupin dépérit dans toutes les terres calcaires contenant plus de 2,5 % de calcaire actif, il aime l’acidité, les climats septentrionaux. Moins sensible aux maladies que la féverole ou le pois, il est toutefois pénalisé par l’anthracnose et la mouche des semis. C’est tout l’objet des travaux en cours visant à préparer le rebond de cette fabuleuse légumineuse.